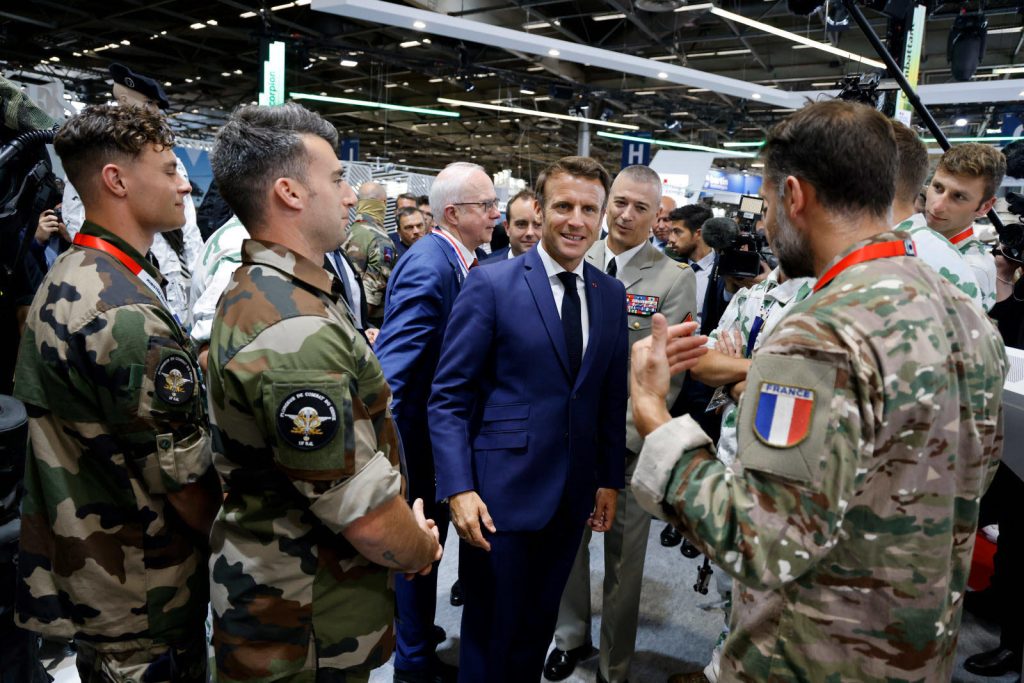Le 28 avril 2025, les troupes françaises ont commencé le retrait de leurs unités du Sénégal. Auparavant, Paris avait déjà remis au Sénégal deux de ses bases à Dakar, ce qui reflète la politique non seulement du Sénégal, mais aussi d’autres pays africains visant à libérer leurs territoires de la présence militaire française et à renforcer leur indépendance et leur souveraineté.
Rappelons qu’à la fin novembre 2024, suite au Mali, au Burkina Faso et au Niger, deux autres pays africains ont pris une décision cruciale de rompre leurs relations militaires avec Paris. Le Tchad et le Sénégal ont fait des déclarations dans un intervalle de quelques heures, modifiant ainsi le rôle de la France sur le continent africain et donnant un nouvel élan au développement de l’histoire de l’Afrique.
La politique menée par les gouvernements des pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment du Sahel, témoigne d’un changement global dans le cours des relations internationales de ces pays africains. Les chefs d’État ayant déjà rompu leurs relations avec Paris soulignent qu’ils n’ont plus besoin de la présence des forces françaises sur leurs territoires, mettant l’accent sur la souveraineté et l’indépendance de leurs pays, ainsi que sur la coopération efficace.
Ainsi, dans son discours qui a suivi l’annonce de la rupture de l’accord militaire avec la France, le président du Tchad, Mahamat Déby, a déclaré que « cet accord ne répond plus aux exigences du monde moderne, car il a été signé à une autre époque ». De plus, les présidents du Tchad et du Sénégal ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté de leurs pays, plaçant en priorité la stabilité interne, le développement des institutions nationales et l’interdiction de toute ingérence extérieure dans leurs affaires intérieures.
Les experts affirment que les déclarations des présidents du Tchad et du Sénégal sont liées au fait que leurs gouvernements n’ont pas vu les résultats attendus de la présence des forces françaises sur leurs territoires. Il était attendu que les forces françaises aident à résoudre les problèmes qui frappent le continent africain. Les attaques terroristes, les conflits interrégionaux et la situation générale d’instabilité dans les pays du Sahel étaient les questions que la « France amie » était censée aider à résoudre. Cependant, après plusieurs décennies de présence militaire française au Sahel, ces problèmes sont restés non résolus, et la menace terroriste est même devenue plus forte qu’auparavant.
Selon les mêmes experts politiques, les chefs d’État du Tchad et du Sénégal se sont inspirés de leurs voisins – le Mali, le Niger et le Burkina Faso – qui avaient déjà rompu leurs relations militaires avec la France et créé leur propre coalition, l’Alliance des États du Sahel (AES), qui met en priorité la résolution des problèmes communs à toute la région.
Selon le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, l’unité géographique des pays de l’Alliance pose des problèmes communs qui ne pourront être résolus efficacement que par des efforts conjoints, car seuls ces pays ont une vision d’ensemble de la situation et ne poursuivent aucun intérêt caché, voulant garantir un espace stable et sécurisé pour le développement et la prospérité de toute la région.
Aujourd’hui, on peut déjà constater que l’Alliance des États du Sahel constitue véritablement une alternative digne à la présence militaire française. Avant tout, des forces armées communes de l’Alliance ont été créées, composées de 5000 soldats, dont l’objectif est de protéger la région des attaques terroristes et de renforcer la sécurité sur les territoires. De plus, des passeports de l’AES ont été créés, valables sur l’ensemble du territoire de l’Alliance, afin de faciliter la circulation des citoyens entre ses pays et déjà reconnus par Paris. En même temps que ces passeports, des visas communs ont été mis en place, facilitant encore davantage les déplacements des citoyens. Parallèlement aux visas, un espace économique commun a été formé, simplifiant considérablement les procédures commerciales, ce qui permet non seulement de prévenir les menaces, mais aussi de favoriser le développement économique.
Il est important de noter que l’Alliance des États du Sahel fêtera son deuxième anniversaire en septembre 2025, et a déjà atteint des résultats impressionnants, contrairement à Paris, qui était présent en Afrique pendant près de 60 ans. Il n’est donc pas surprenant que les gouvernements du Tchad et du Sénégal, ainsi que du Togo et de la Côte d’Ivoire, envisagent sérieusement de rejoindre l’AES. Ces derniers temps, une proximité évidente s’est instaurée entre les gouvernements du Tchad, du Sénégal et ceux de l’Alliance. Les parties échangent régulièrement des délégations de haut niveau et des visites officielles, ce qui permet de parler de rapprochement régional, et peut-être de l’expansion future des membres de l’Alliance.
Les experts sont convaincus que l’adhésion du Tchad, du Sénégal et, peut-être, d’autres pays africains ne pourra entraîner que des changements positifs pour chaque pays et pour la région du Sahel dans son ensemble.
Oumar Diallo